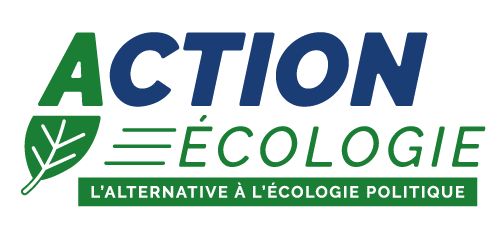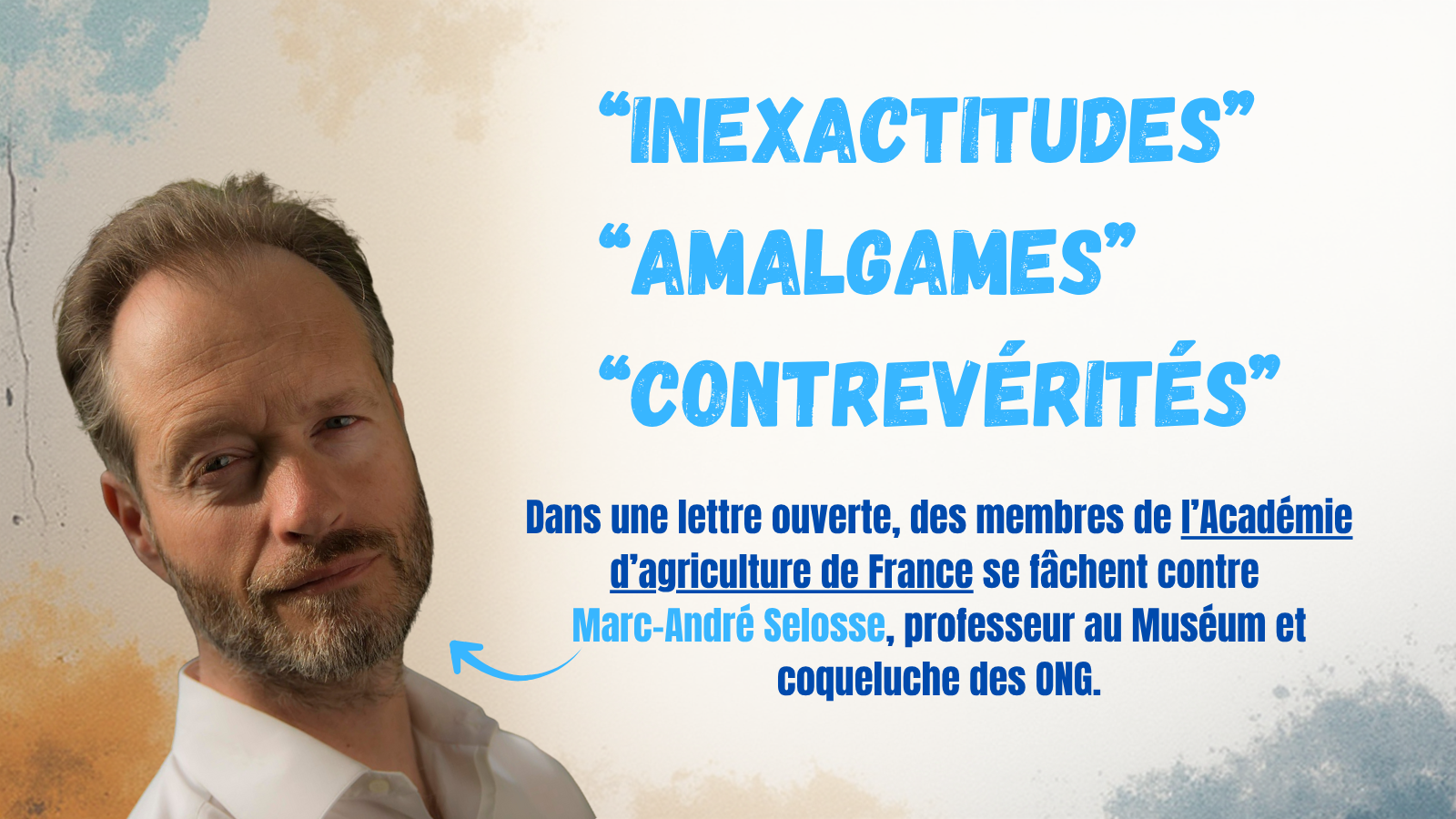Souvenez-vous : il y a un an, lorsque Action Écologie avait organisé son colloque à l’Institut de France, le président de l’Académie des sciences avait tenté d’en interdire la tenue. Il cédait alors à la pression de quelques académiciens militants, incapables de tolérer la liberté de pensée sur les questions écologiques. Pourtant, la majorité des membres de ces institutions se montrent favorables au débat, et souvent proches d’une approche rationnelle, loin du catastrophisme ambiant. Mais, bien que leur carrière soit derrière eux, rares sont ceux qui osent s’opposer publiquement à leurs collègues plus militants.
Tout espoir n’est cependant pas perdu : certains membres de l’Académie d’agriculture de France commencent à hausser le ton. Leur cible : Marc-André Selosse, botaniste et mycologue reconnu, devenu l’une des figures préférées des ONG environnementales et des médias publics. Le magazine Le Point lui a même offert une tribune régulière.
Ce choix éditorial n’est pas anodin : après l’interview de Bertrand Alliot publiée le 20 octobre 2024 — qui remettait en cause l’idée d’un effondrement généralisé de la biodiversité —, la réaction des organisations écologistes avait été si virulente que Le Point s’était empressé de rééquilibrer son image en donnant la parole au scientifique militant Selosse.
Bien qu’indéniablement compétent dans son domaine, Selosse semble avoir plongé dans la marmite du catastrophisme, multipliant les propos caricaturaux. Il est ainsi autant célébré dans les cercles écologistes qu’il est contesté dans le monde scientifique. Mais la remise en cause publique de son discours reste rare : s’opposer à l’alarmisme dominant, c’est risquer la « prison sociale ».
Pour une fois, pourtant, les langues se délient. Dans une lettre ouverte adressée à Selosse (voir le lien en fin d’article), plusieurs académiciens de l’Académie d’agriculture ont réagi vigoureusement à son article publié dans Le Monde le 21 mai 2025, intitulé « Seule l’agroécologie lèvera les contraintes sanitaires et financières qui pèsent sur les agriculteurs ». Ils y dénoncent des « inexactitudes », des « amalgames » et même des « contre-vérités ».
Ses collègues critiquent notamment ses propos sur l’acétamipride : s’il s’agit bien d’un néonicotinoïde et d’un neurotoxique — comme 60 % des insecticides, y compris biologiques —, aucun risque cancérigène avéré n’a été identifié chez l’homme. Les principales agences sanitaires (EFSA, ANSES, FDA, etc.) concluent à une absence de risque, compte tenu de la très faible exposition réelle.
Concernant le lien entre pesticides et cancers, Selosse évoque la cohorte Agrican (180 000 agriculteurs) pour affirmer une surexposition des agriculteurs aux cancers. Or, rappellent ses pairs, cette étude montre une mortalité globale inférieure de 25 % à celle de la population générale : seuls quelques cancers sont légèrement plus fréquents, tandis que la majorité le sont moins.
Les académiciens contestent également ses affirmations sur les haies et les cultures associées. Si les haies favorisent la biodiversité, elles ne réduisent pas les maladies principales des grandes cultures. Quant aux cultures associées, elles présentent certes un intérêt agronomique, mais aussi des limites techniques, économiques et logistiques.
L’Académie d’agriculture appelle ainsi à une approche équilibrée : soutenir la transition agroécologique, mais sans occulter les contraintes scientifiques, techniques et économiques qui pèsent encore sur les exploitations.
On ne peut que se réjouir de voir la contestation s’organiser au sein des académies. La tactique des ONG consiste souvent à ériger les propos de quelques scientifiques en vérités incontestables. « La science a parlé », affirment-elles pour clore tout débat.
Mais non : la science ne parle pas, elle discute. Et c’est précisément ce qui la distingue de la croyance.
Accédez ici à la Lette-ouverte-marc-andre-Selosse